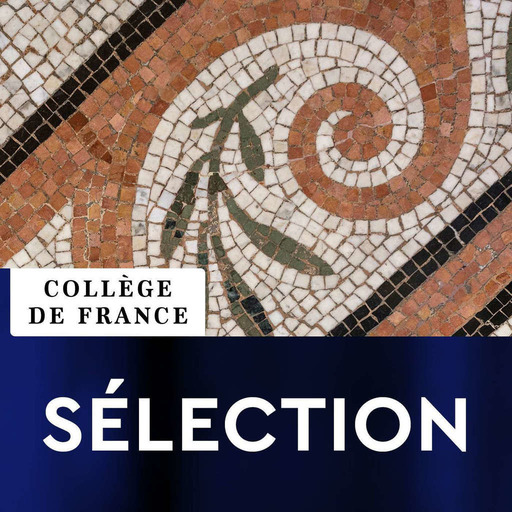Edith Heard
Chaire Épigénétique et mémoire cellulaire
Collège de France
Leçon inaugurale : Épigénétique et mémoire cellulaire
Date : 13 décembre 2012
Résumé
Au cours du siècle passé, des progrès considérables ont été réalisés, nous permettant de mieux comprendre les bases moléculaires de l'hérédité ainsi que les processus permettant à nos informations génétiques d'être stockées, lues et répliquées par l'ADN. Chez les organismes complexes, le défi consiste à comprendre comment l'ADN est enroulé dans le noyau, comment il est exprimé ou « lu » dans certaines cellules et pas dans d'autres, et à comprendre comment les gènes sont régulés pour produire une grande diversité de cellules. Pourquoi est-ce que des personnes ayant des génotypes identiques (par exemple des jumeaux, ou même, chez les abeilles, des ouvrières par opposition aux reines) présentent des différences au niveau de leur phénotype ? Comment une seule cellule, l'ovule fécondé, peut-elle donner des centaines de types de cellules différentes, avec chacune un rôle spécialisé durant le développement de l'organisme, et ce malgré le fait que l'information de l'ADN est identique dans chacune de ces cellules ? Comment des gènes peuvent-ils être exprimés dans certaines cellules alors qu'ils ne le sont pas dans d'autres ? Comment est-il possible qu'un type particulier de cellule sache non seulement quel gène reproduire, mais se souvienne également qu'il doit continuer de l'exprimer, parfois pendant plusieurs années, ou sur des centaines de cycles de division cellulaire ? Par ailleurs, une fois la différenciation réalisée, comment est-il possible que ce processus soit parfois réversible ? Par exemple, au moment de la fécondation, lorsque les cellules très différenciées que sont les cellules du sperme et de l'ovule sont en présence les unes des autres, tout repart en quelque sorte à zéro afin de créer la vie. Ou dans le cas du cancer, où l'on constate souvent une dédifférenciation. Ou encore dans nos éprouvettes, alors que nous savons qu'un nombre limité de facteurs protéiniques (qui régulent les gènes) sont capables de réadapter des cellules afin de générer tout un organisme. Ce processus laisse entrevoir d'extraordinaires potentiels thérapeutiques ; cependant, il est lent et inefficace, pourquoi ? Quels sont les obstacles ? Toutes ces considérations ont quelque chose à voir avec le fait que l'ADN est associé à des modifications chimiques, à des protéines et à l'ARN qui sont tous susceptibles de moduler sa lisibilité – et par conséquent l'expression des gènes – ainsi que le caractère héréditaire des états d'expression par la division cellulaire.
Tout ceci relève de ce que nous appelons aujourd'hui « l'épigénétique », mot composé du préfixe grec « epi », qui signifie au-delà ou au-dessus, et du mot « génétique ». En tant que discipline scientifique, l'épigénétique a su captiver l'imagination du public au cours des dernières années, plus particulièrement depuis que nous avons, pour la première fois, été en mesure d'« apercevoir » la séquence du génome humain il y a un peu plus de dix ans. Pour passionnante qu'elle fût, cette étape fût également très intimidante car nous étions face à la réalité – et peut-être au caractère inévitable – de cette génétique qui nous constitue. Cette prise de conscience s'est accompagnée de la réalisation du fait que nous allions désormais pouvoir lire, comme dans un livre, nombre des traits qui nous caractérisent – nos forces, nos faiblesses, nos prédispositions aux maladies, etc. – (avec tous les problèmes éthiques et philosophiques que cela implique). L'idée selon laquelle l'épigénétique – c'est-à-dire la manière dont est lu notre génome – pourrait nous permettre d'espérer que nous sommes plus que la simple addition de nos gènes, a suscité un vif intérêt et une grande curiosité dans le public et les média. Sommes-nous en quelque sorte capable d'échapper au caractère inéluctable de notre constitution génétique ? Est-ce que ce que nous mangeons, est-ce que l'air que nous respirons, et même, est-ce que les émotions que nous éprouvons peuvent influencer non seulement la manière dont nos gènes sont exprimés mais aussi la manière dont seront exprimés demain les gènes de nos enfants et de nos petits-enfants ?
Il est absolument certain que l'environnement dans lequel nous vivons peut influencer la manière dont nos gènes sont exprimés, et que cela peut parfois entraîner des modifications stables du phénotype – et dans certains cas, des maladies. Cependant, il en va autrement dès lors que l'on cherche à savoir dans quelle mesure de telles modifications peuvent être transmises d'une génération à une autre. Au cours des dernières années, il est apparu clairement que des caractéristiques qui ne sont pas dues à des modifications de la séquence de l'ADN peuvent être transmises d'une génération à une autre chez certains organismes vivants, en particulier dans le règne végétal ; la question est donc : quel est le rôle de l'environnement ? Et ce type de processus peut-il se produire chez l'homme ? Et si oui, dans quelle mesure ? Nous ne disposons pour l'instant d'aucune réponse claire à ces questions.
S'il est évident que le sujet de l'épigénétique a suscité un véritable engouement dans les média, l'amalgame de faits scientifiques et de fantasmes auquel nous assistons est dangereux et susceptible de nuire aux avancées de la science et à notre compréhension. Fort heureusement, la recherche scientifique progresse très vite dans ce domaine et devrait nous fournir des réponses et des éclaircissements dans les années à venir.
Dans le cadre de cette chaire en Épigénétique et mémoire cellulaire, je me propose de présenter les travaux et les idées qui constituent la base de ce nouveau champ de recherche tout en envisageant les espoirs et craintes qu'il peut susciter. Il ne s'agit pas là d'une tâche aisée car le mot « épigénétique » lui-même avait été créé en 1942 par Conrad Hal Waddington, pour décrire le lien entre génotype et phénotype pendant le développement. Dans les années 1990, le mot a pris une définition qui l'associait à la notion d'héritabilité. Les définitions les plus récentes parlent de l'adaptation structurelle des régions du chromosome afin d'enregistrer, de signaler ou de perpétuer des états d'activité altérés, par l'intermédiaire d'influences environnementales sur l'expression des gènes. C'est la raison pour laquelle l'intitulé de cette chaire inclut la notion de « mémoire cellulaire » car il convient d'inclure la notion de maintien et de propagation d'un état particulier de l'activité des gènes, ou de l'enroulement des protéines, ou d'une structure cellulaire, et ce tout au long des différentes échelles temporelles de la vie – comprenant le cycle cellulaire, l'organisme, ou le passage d'une génération à une autre. Cette mémoire cellulaire peut être stable ou transitoire – elle peut être soit programmée de telle sorte qu'elle soit réversible, ou disparaître accidentellement au cours de la vie. Dans certains cas, une telle « amnésie » peut entraîner un dysfonctionnement et la maladie, alors que dans d'autres, elle peut s'avérer être un avantage et dévoiler de nouvelles fonctions à partir desquelles peut s'opérer une sélection. Voici en résumé quelques-unes des notions que je souhaite étudier dans les années à venir.


 Education
Education