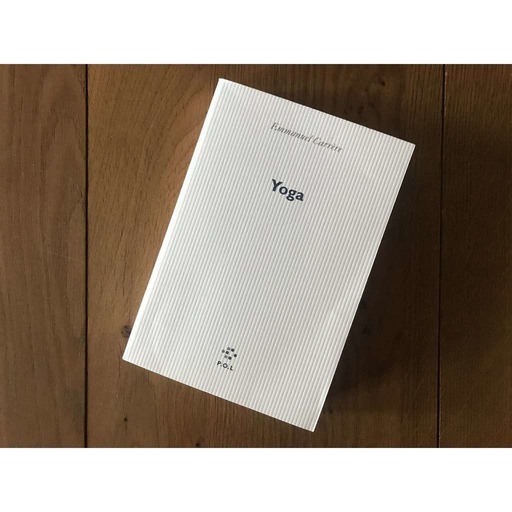Samedi dernier, j'eus le plaisir de participer à un échange en ligne passionnant, directement inspiré des apéros Zoom en temps de confinement, avec un poète italien. Dans son remarquable premier roman intitulé Je suis la bête apparaissent, gravés sur une table, deux mots lapidaires et surprenants : "Andrea suce". Interrogé sur leur sens profond - qu'il se prénomme lui-même Andrea (Donaera) suscitait une curiosité légitime -, l'écrivain évoqua sa tendence naturelle à l'insatisfaction dès qu'il tente d'évaluer son propre travail, et le besoin concomitant de se rabaisser aux yeux d'autrui. Avant d'ajouter, sourire en coin pendant la traduction : "Enfin, pas comme Emmanuel Carrère, vous comprenez ?"
Rappeler l'anecdote a au moins deux mérites. Le premier consiste à ainsi rendre hommage à l'auteur de Yoga, dont l'habitude est justement de se mettre en scène quel que soit le sujet qu'il aborde - ici, j'entame la chronique de son dernier livre en glissant l'air de rien que je ne passe pas mes week-ends entiers devant NRJ 12. Le second est de corroborer une intuition : comme celle de son talent, la réputation de l'ego d'Emmanuel Carrère a largement dépassé nos frontières. Or le sacripan en fait carrément le sujet de son dernier opus. Qu'on ne s'y trompe pas : comme de juste, Yoga parle beaucoup de yoga, ou plutôt de méditation, activité essentielle et salvatrice dont il est l'une des voies d'accès. Mais le propos d'Emmanuel Carrère, qui comptait à l'origine dédier au sujet un "petit livre souriant et subtil" bien dans son époque, dérive rondement vers une explication étoffée de son propre attrait pour la discipline, et des failles intimes qu'elle lui aura permis de résorber, ou pas du tout, ou du moins pas tout le temps.


 Emissions
Emissions